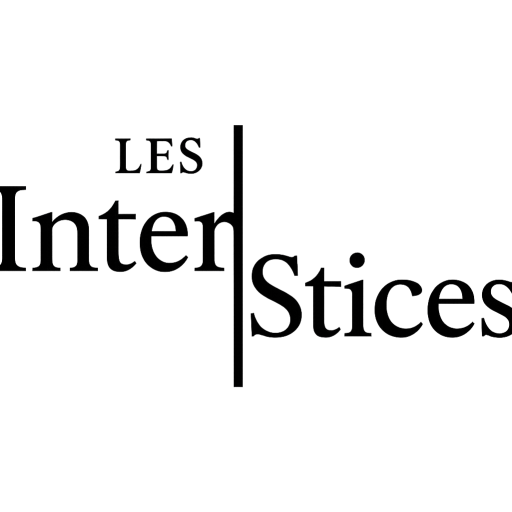Ténèbres sans nuances.
Dans les méandres du Creux, rien ne se voit, rien ne s’entend. Si ce n’est les palpitations des corps et le souffle des respirations.
C’est un lieu radical.
Où toutes les absences se nouent dans le secret.
Jusqu’à ce qu’une lueur glisse en un éclair dans le noir parfait. Son sillage le traumatise tant qu’elle laisse une plaie incandescente dans les ténèbres.
Une plaie qui, même lorsque la lueur s’est éteinte, éclaire le corps de l’abysse qui ne devait se découvrir.
Et les absences se révèlent. Fils de soie entrelacés, qui se rejoignent en carrefours qui frémissent lorsque des pattes éveillées les effleurent.
Elles sont si fines et longues, qu’elles paraissent prolonger la soie. La noirceur des membres tranche avec la clarté révélée de la toile gigantesque qui recouvre l’immensité de l’abysse. En suivant les huit pattes – qui se tiennent en équilibre précaire sur quatre fils différents – on découvre une petite sphère tout aussi sombre, d’où émerge une constellation de petites boule de lumière qui s’ignoraient.
L’ouvrière découvre son corps. Elle soulève l’une de ses pattes, braquant ses dizaines d’yeux sur cette baguette de noirceur où les trichobotries ressentent pour la première fois, la friction de l’air. Elle met un long moment à comprendre, et ce n’est que lorsqu’elle secoue sa patte raide comme une aiguille, qu’elle comprend que cette chose est sienne. Mieux elle comprend, plus elle secoue. Plus elle secoue, plus elle se dandine. Ses yeux s’illuminent plus encore alors qu’elle sautille d’excitation à se découvrir.
La soie se balance, sous le poids de la créature. Surprise par le phénomène qu’elle a elle-même provoquée, elle manque de perdre son équilibre et se cambre pour rétablir sa prise.
Ses trichobotries restent alertes tout le temps où les secousses agonisent. Les yeux clos plongent à nouveau ses sens dans des ténèbres familières. Ses huit membres à nouveau prostrés dans une immobilité totale, la créature craint le mouvement comme on craint la mort.
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que maintenant qu’elle a découvert sa propre existence, sa vie est aussi inéluctable que sa mort.
C’est cet instinct bourgeonnant, qui la pousse à entrouvrir ses yeux, et redécouvrir sa patte.
Toujours là.
Toujours sur la soie.
Et, écrit dans ses gênes comme l’empreinte du vivant dans un fossile, la créature se rappelle instinctivement comment bouger ses pattes sur ce fil.
L’une, après l’autre.
La soie vibre sous ses enjambées déjà assurées, malgré tout le stress qui érige ses trichobotries.
L’araignée glisse sur la toile, et explore l’abysse.
La lumière rémanente, attire la créature comme un aimant. Elle se laisse porter par ce curieux phénomène qui ne devrait pas être dans l’abysse. Autour d’elle, elle aperçoit pour la première fois des formes curieuses, rectangulaires ou triangulaires, dont les détours se découpent dans le clair obscur.
Les formes grimpent jusqu’à des sommets si haut que la lumière ne peut totalement les lui révéler. Elles composent les limites de l’abysse, et en regardant les surfaces lisses, l’araignée voit se réfléter partout autour d’elle, la lumière encore incandescente.
Elle ne peut se diriger directement vers la lumière, le maillage de la toile est insuffisant. Dès qu’elle pense avoir trouvé un chemin, elle tombe sur un fil de soie tranché, qui se perd en filant dans les ténèbres en contrebas. Malgré le stress qui fait se dresser ses prolongements érectiles, la créature est trop curieuse pour s’arrêter.
Lorsqu’en allant un peu trop sur la gauche, un obstacle lui barre la vue, et qu’elle perd la lumière, elle revient sur ses pas. Elle choisit le chemin qui lui permet de suivre ce phare, même si elle doit faire des détours.
Arrive un moment où il y a un précipice entre son côté de la toile, et l’autre bout où l’attend la suite de son périple. Elle se rappelle de l’instabilité de son support, et commence à remuer son arrière train, cambrant ses huit pattes en regardant à l’autre bout du précipice.
Il faut être très jeune, ou particulièrement téméraire pour tenter ce genre de manoeuvre.
Si notre amie l’arraignée n’est pas des plus courageuses, elle est par contre des plus ignorantes. C’est pour ça qu’elle se cambre une dernière fois, et profitant de l’élasticité de la toile : bondit.
Le frottement de l’air sur ses trichobotries a très tôt fait de l’agiter. Elle cherche alors du bout de ses pattes, un sol qu’elle vient de quitter. Si l’instinct lui a indiqué qu’elle pouvait sauter, son système nerveux, lui, semble ne pas apprécier les choses de la même façon.
Et lorsqu’elle passe, à quelques millimètres près de sa cible, la panique s’empare de son corps.
Et notamment d’un appendice, à l’arrière de son corps. Elle se replie sur elle-même, brandissant son derrière comme une arme et d’un orifice jaillit une lance blanche et visqueuse.
Le fluide s’accroche à la soie en hauteur. Lorsqu’elle se balance, tenu par le produit de ses entrailles, l’araignée balance ses pattes en l’air, paniquée.
Toutes ses trichobotries sont droites comme des aiguilles. La créature s’accroche à sa corde organique, et progressivement, pose le bout de chacune de ses pattes dessus, avant de se hisser.
C’est difficile, elle ne connaissait pas le poids de son corps, et notamment de ce derrière qui se cachait à elle. Mais elle grimpe petit à petit, gagnant en aisance, manipulant la soie comme une couturière la laine.
Bientôt, elle retrouve le plancher des arachnides, et ses organes érectiles se relâchent lentement de toute cette tension accumulée. Bien vivante, l’arraignée poursuit sa quête de lumière.