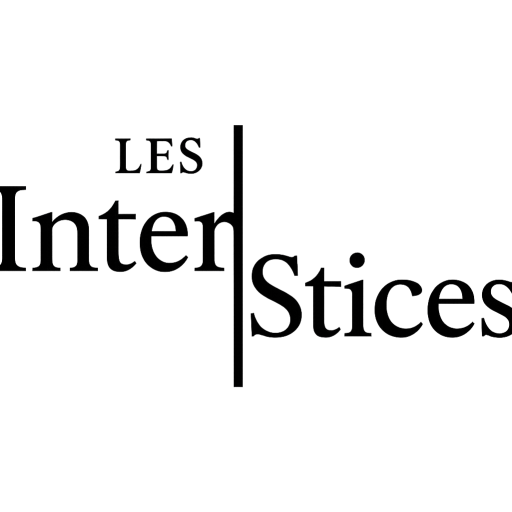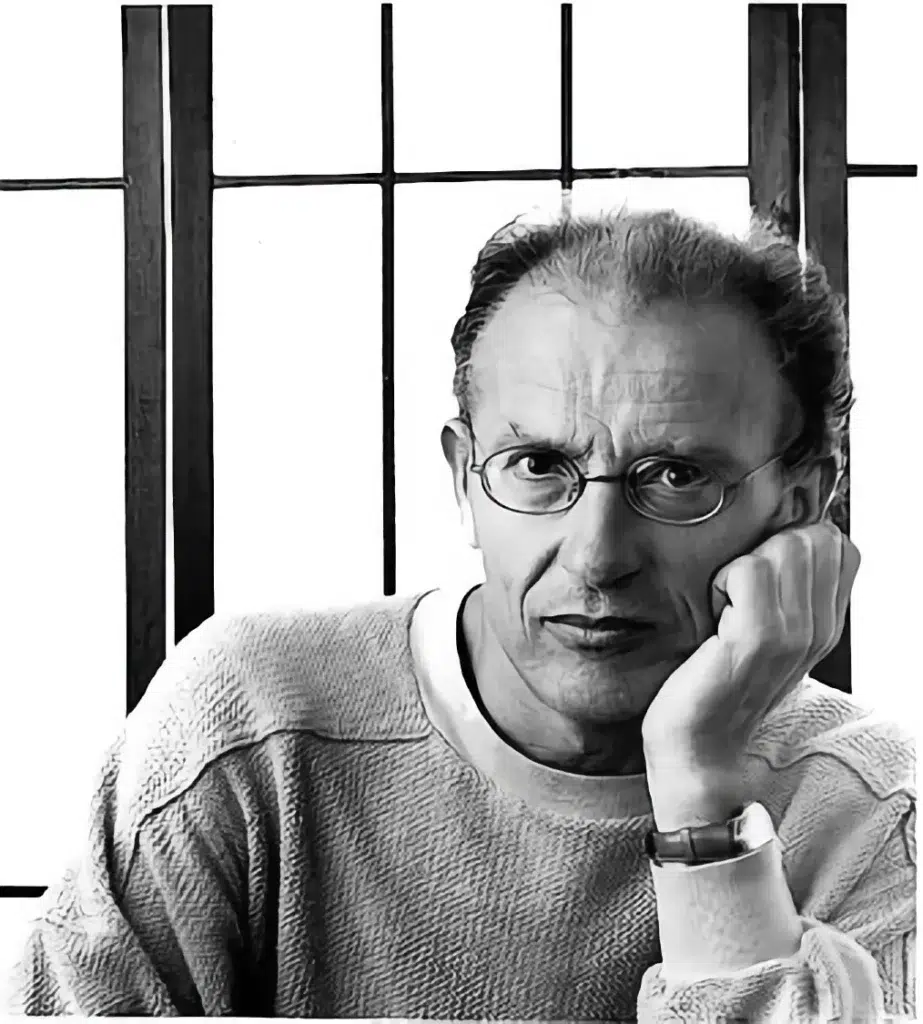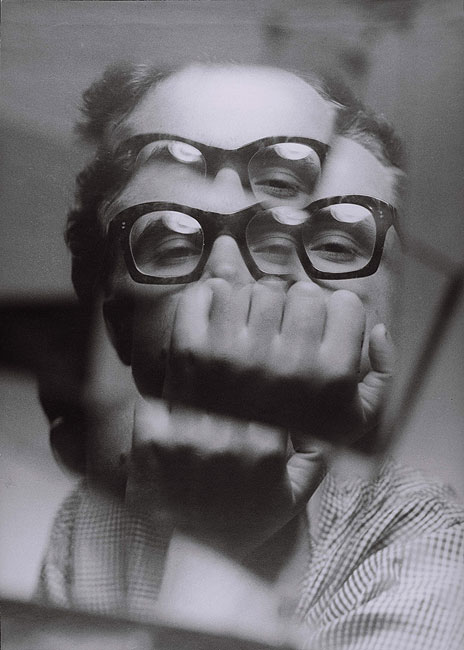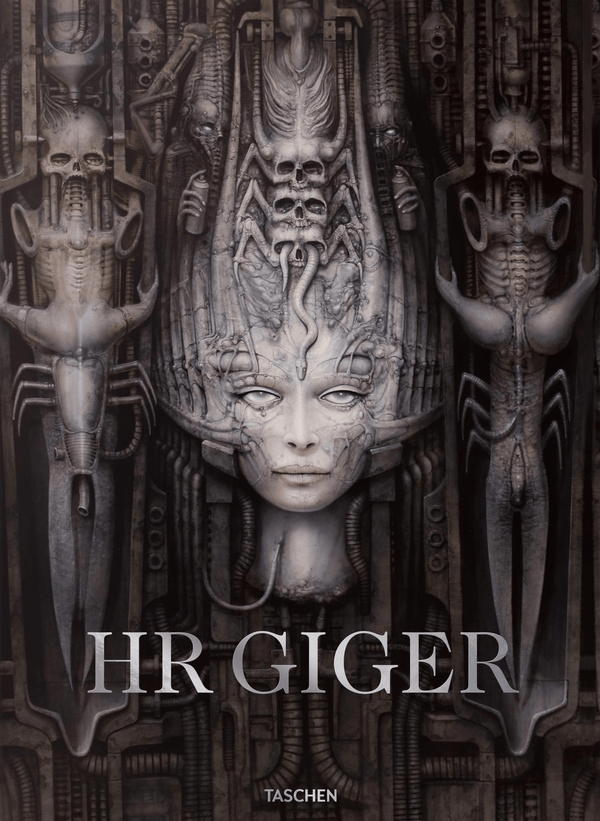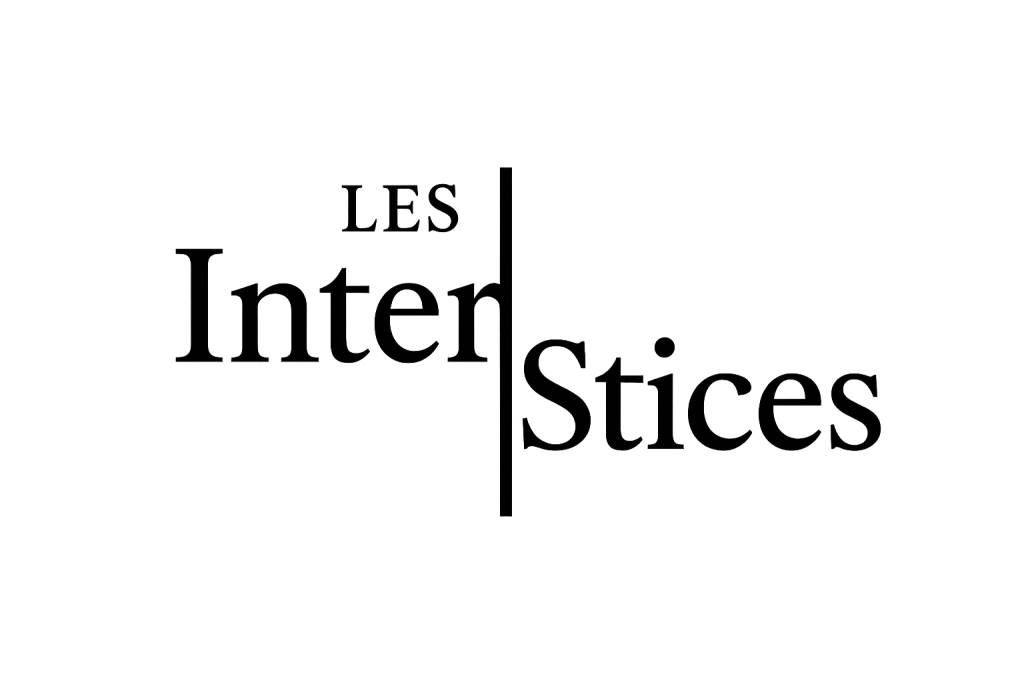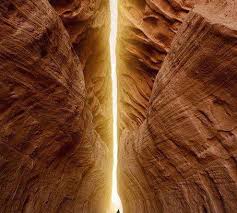Les USA ont Disney, le Japon a Ghibli. Une manière simple de mettre sur un pied d’égalité deux titans de l’univers de l’animation bien que mon coeur soit plus à l’ouest. Miyazaki c’est aujourd’hui un nom qui signifie des choses différentes pour les générations milléniaux et celle des Z. D’un côté, ils se représentent encore le réalisateur d’un Château dans le Ciel, les autres sont plutôt à penser au réalisateur de Dark Souls. Faut dire que les homonymes sont nombreux et que l’algorithme ne fait pas toujours le tri entre les légendes !
L’Architecte des Rêves
On parlera ici du premier, de celui qui a co-fondé le Studio Ghibli en 1985. Non pas que je manque de respect et d’admiration pour le second, mais la trace que Hayao a laissée sur moi est bien plus prononcée.
Miyazaki, c’est l’anti-Disney. Là où l’usine à rêves américaine a tendance à lisser, à simplifier la morale, à mettre une grosse pancarte « Gentil » ou « Méchant » sur chaque personnage, le cinéma de Ghibli, c’est l’ambiguïté. C’est le gris. On ne sait jamais vraiment si les esprits de la forêt vont vous bénir ou vous trucider. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de manichéisme dans l’univers de Ghibli, c’est juste qu’il le bien et le mal s’incarne de façon plus subtile. C’est l’histoire qui révèle la moralité des actions, tout n’est pas clair dès le départ.
C’est ça, la magie : une vision du monde où la nature n’est pas un joli décor mais une force vive, magnifique. Ses héroïnes, surtout, sont une leçon d’écriture. Pas de princesses à sauver, mais des petites (ou grandes) femmes qui agissent sur leur monde. Pensons à Chihiro, à Nausicaä, à Kiki : elles sont autonomes, elles ont des doutes, elles se trompent, mais elles avancent.
Cette figure du personnage féminin fort qui n’a pas attendu me too pour émerger m’a beaucoup inspiré. D’Iris à Thaïs en passant par Résilé, Marion et Narra, je n’ai eu de cesse d’imaginer spontannément des personnages féminins pour mes histoires. Et ce, sans la moindre arrière pensée ni même message féministe à faire passer. Je pense que c’est notamment dû à Chihiro qui m’a énormément impacté dans l’enfance. Je pourrais aussi citer plus récemment Nausicaä dont la présence à l’écran m’a beaucoup marqué.
L’Héritage d’un Retraité Infatigable
Combien de fois le créateur des studios Ghibli a-t-il annoncé sa retraite ? Cinq ? Six ? On a arrêté de compter après Le Vent se lève. Et à chaque fois, il revient, avec cette même exigence du dessin à la main, du crayon visible. Il est sans doute pour lui important de rappeler que l’animation par ordinateur n’est pas la seule voie vers l’émotion pure, bien au contraire. J’espère avoir moi-même cette faim créatrice qui empêche le repos. Comme Miyazaki, j’espère être superbement ridicule lorsque j’annonce la fin de ma carrière pour à nouveau trahir avec plaisir mes lecteurs. Je pense que c’est la plus belle preuve de sa volonté : pieds et poings liés à son imaginaire.
Avec Le Garçon et le Héron, il prouve que même à un âge vénérable, son imagination n’est pas encore tari. Bien sûr, on commence à voir ses propres ficelles, mais il reste un film intéressant. C’est peut-être son œuvre la plus personnelle, un véritable testament artistique qui nous balade entre son enfance, la guerre et des mondes plus bizarres et touchants que jamais. Plus on avance dans le temps, plus la griffe et les obsessions du réalisateur deviennent évidentes. Cela créait selon moi une relation touchante et intime avec lui : on sait déjà ce qu’il a à dire, et on est juste heureux qu’il itère sur sa vision.
Son influence sur mon travail
Je pense que si l’on considère l’influence qu’il a eu sur mon travail, il y en a deux types : directe et indirecte. L’univers de Les Ailes de Narra n’est pas étranger à l’esthétique et la poésie de Miyazaki. On y retrouve sa contemplation, son sens du rythme et du rapport avec la nature, sans oublier sa poésie. Miyazaki est extrêmement proche de l’environnement et aime souvent l’opposer à l’industrie. C’est probablement dû à l’industrialisation massive du Japon dans l’après guerre qu’il a vécu dans sa chair. Aussi, dans l’univers de Mer (et donc des Ailes de Narra) le récit met en scène des enfants aux prises avec le monde des adultes, thème aussi cher au réalisateur Japonais.
Plus indirectement, je pense que ce qui m’a inspiré chez Miyazaki c’est ce regard. Ce détail persistant qu’il apporte à ses oeuvres, son besoin de rendre hommage aux plantes, aux insectes. Ses univers fourmillent de vie. Même si j’ai tendance à plus faire fourmiller des symboles mortifères, je pense avoir attrapé ce virus de vouloir « peindre » des univers. J’essaye de leur insuffler ce supplément de vie qui fait qu’ils « persistent » dans notre mémoire.
Pour moi, Miyazaki c’est une esthétique de l’espoir et du réalisme. Ses récits sont sombres, mais ses protagonistes triomphent par la pulsion de vie. Le bien triomphe parce que ses personnages sont encore au contact avec les besoins de leurs proches. Ils sont unis par cette pulsion à rester connectés à ce qui les entoure. Je crois qu’il y a un peu de ça dans mes récits, bien que mes personnages aient souvent tendance à être profondément seuls – individualistes même – et se rencontrent parce que leurs existences ne les satisfont pas. Parce que la solitude est bien souvent la conséquence des blessures, jamais une volonté.
La rencontre. Voilà peut-être ce que je dois à Miyazaki, cette volonté de faire rencontrer les mondes et les personnages. J’espère conserver comme lui cette faim de créer jusqu’au bout. C’est selon moi l’un des plus grands créatifs de son temps et j’en veux pour preuve sa longévité.