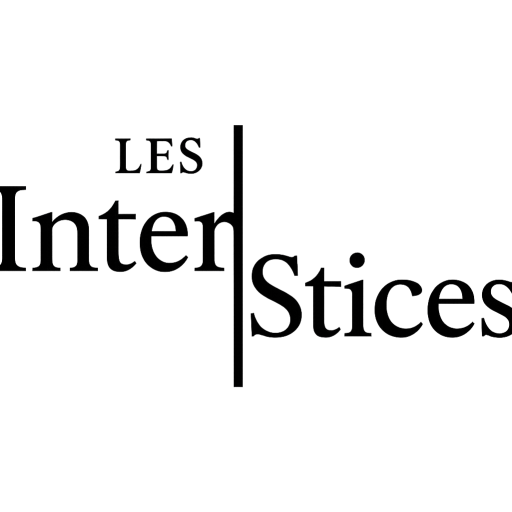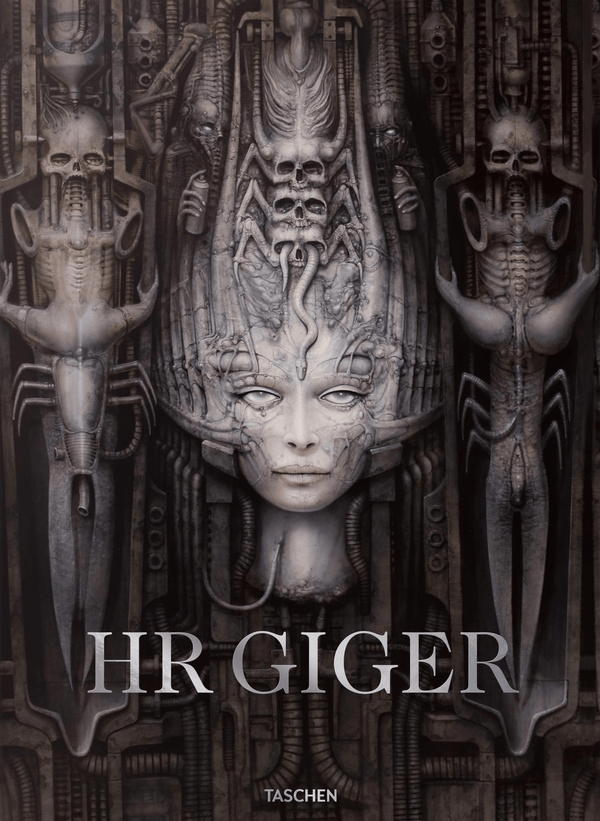La liberté… tout un programme !
Lorsque j’écris mon premier « vrai » roman en 2022, je l’écris dans une volonté de libération de mon imaginaire. Personne n’était coupable d’un enfermement à part moi-même et mes obsessions. Je tournais en boucle sur la même idée de trilogie depuis plus de dix ans.
Ce besoin d’être libre s’est matérialisé dans la création de l’univers du « Oïtl » aux règles suffisamment permissives pour que je ne m’y sente pas à l’étroit. Bien sûr, on est jamais assez libre et on est toujours tenté de s’enfermer. Je me suis donc progressivement dégagé des marges supplémentaires.
C’est aussi le sentiment que j’ai avec le travail de Jean Giraud : il n’a jamais été assez affranchi. Sa carrière est marquée bien sûr par un style, mais il lui permettait des explorations d’un imaginaire si vaste que j’ai toujours senti une forme de joie et de liberté dans son travail.
Enfin, tout ça, c’est pour introduire le sujet. On va d’abord parler du bonhomme avant d’explorer ce qu’il m’a inspiré, faisons les choses dans l’ordre !
Une vie dédiée à l’art et à l’imaginaire
Jean Giraud, né le 8 mai 1938 à Nogent-sur-Marne et décédé le 10 mars 2012 à Paris. Dès son adolescence, il se passionne pour la science-fiction et le dessin, étudiant aux Arts appliqués à Paris. Il adopte plusieurs pseudonymes au fil de sa carrière : Gir pour ses westerns et Moebius. C’est sous ce nom qu’il signe les oeuvres qui vont le rendre célèbre et caractériser sa patte.
Des débuts prometteurs
Giraud commence sa carrière en collaborant avec des maîtres comme Jijé, qui lui confie des planches de Jerry Spring. En 1963, il crée avec Jean-Michel Charlier la série Blueberry, un western réaliste qui devient un classique du genre. Sous le nom de Moebius, il explore des univers plus oniriques et futuristes. Il publie des œuvres comme Arzach (1976) et Le Garage hermétique (1979), qui révolutionnent l’esthétique de la BD. Elles sont, par ailleurs, les oeuvres qui m’ont le plus inspiré dans son travail. C’est avec ces deux bande dessinées que je suis frappé par son coup de crayon et que je commence à apprécier les couleurs. J’ai toujours eu une relation contrariée avec la couleur dans la bande dessinée. Mais chez Moebius, cela explose et ça incarne un esprit où les digues semblent avoir pété pour laisser se déployer un imaginaire parfaitement vivant et libre.
L’Incal et la collaboration avec Jodorowsky
L’une de ses collaborations les plus célèbres est avec Alejandro Jodorowsky pour L’Incal (1980–1988), une saga de science-fiction métaphysique. Ce projet, né d’une tentative avortée d’adaptation cinématographique de Dune, devient une référence absolue du genre. Ce qui m’amuse particulièrement, c’est de voir la circularité des références : étant assez friand de l’adaptation cinématographique de Dune en 1984 (moins de celle de Villeneuve alors que je suis fan de Blade Runner 2049… allez savoir !) apprendre que Moebius a bossé sur une adaptation avortée puis transformée en projet indépendant de Dune, ça remet beaucoup de choses en perspective. Dans mes influences personnelles, il y a toujours un moyen de retracer une filiation. D’où mon idée que tout ça est amené à se rencontrer et se nourrir mutuellement.
Nota Bene : le projet avorté du Dune de Jodorowsky donnera naissance à un storyboard complet accessible jusqu’aux effets spéciaux décidés en amont. Il inspirera notamment la production d’Alien et d’un certain… Star Wars.
Vous la sentez la circularité des références ?
Un style unique et une influence mondiale, ainsi qu’une résonnance durable dans la science fiction
Moebius est reconnu pour son trait précis, ses paysages oniriques issus de ses inspirations surréalistes et sa capacité à mêler poésie, philosophie et aventure. Son travail influence des générations d’artistes. Du cinéma (Alien, Tron, Le Cinquième Élément) à la musique, en passant par les jeux vidéo. Je citerai notamment le jeu Sable de Shedworks sortie en 2021 et qui en est un vibrant hommage assumé. Il cofonde le magazine Métal Hurlant et la maison d’édition Les Humanoïdes Associés, qui deviennent des piliers de la BD alternative.

Screenshot de Sable, hommage à Moebius avec une adaptation libre de son style
Pourquoi Moebius reste-t-il une référence de la science fiction française ?
Moebius a d’abord été un coup de crayon singulier pour moi. Si on en entend encore parler, c’est parce que son style visuel d’inspirations multiples (et notamment de ses voyages en Amérique du Sud) a résonné au delà des frontières de l’hexagone.
Je pense aussi que sa force est d’avoir su varier les registres et les genres : Western, science-fiction, fantastique, métaphysique… et parfois les marier ensemble. Il ne s’est pas « installé » quelque part, il a étendu le spectre de son travail sans chercher de rentes créatives. C’est ce qui lui permet de toucher large et de déployer un imaginaire si vaste. Il était libre, et ça se sentait, et ça a suscité l’admiration au-delà de son talent.
Et comme il s’est fait remarqué, il a pu collaborer avec de grands noms : des réalisateurs (Luc Besson, Ridley Scott), des scénaristes (Jodorowsky), et bien d’autres. Moebius était un homme qui inspirait même ceux qui inspiraient et a influencé des noms qui ont fait le cinéma et la bande dessinée (ainsi que le jeu vidéo d’ailleurs) du présent et de son futur. Si bien que par ricochet et héritage, son nom demeure jusqu’à aujourd’hui sur de nombreuses lèvres, dont les miennes !
Sinon engagé, un artiste résolument politique
J’ai beaucoup abordé la forme de l’oeuvre de Moebius, mais ça serait faire affront à ce que ça dit. En tant qu’esprit libre, le travail de Giraud mêle spiritualité et critique sociale. L’Incal incarne l’esprit libertaire de Moebius et de son temps (années 60 notamment). On y trouve le refus des dogmes, l’exploration des consciences, et une vision de l’humanité à la fois sombre et pleine d’espoir. L’œuvre influence profondément la science-fiction mondiale et notamment le cinéma (Blade Runner, Le Cinquième Élément).
Ce travail du contraste d’ailleurs avec ce regard sombre qui n’oublie pas la dynamique d’espoir, est capitale dans ma vision. J’aime bien les ambiances crépusculaires parce qu’elles travaillent constamment le contraste. On est toujours en lutte pour améliorer les choses et pour faire jaillir la lumière de l’obscurité. C’est une méthode vieille comme le monde en art, mais c’est quelque chose qui aide à nuancer les rythmes narratifs et les messages. La morale ne saurait être blanche ou noire dans ces récits, toujours dans une nuance de gris qui invite le lecteur à s’investir en lui donnant des marges d’interprétations.
Un collaborateur… indépendant
Moebius a collaboré avec les grands noms de son époque mais est resté un artiste indépendant, refusant les carcans. Son influence se ressent encore aujourd’hui, dans des expositions, des rééditions, et des hommages, comme la sortie prévue en 2025 de ses Carnets personnels. Ces derniers promettent de révéler de nouvelles facettes de son génie créatif.
Je me reconnais beaucoup dans cette vision où se mêle poésie, anticipation, science fiction et fantastique tout en étant en contact avec l’actualité de son temps. Giraud n’avait pas besoin de revendiquer politiquement pour exister dans le champ créatif. Il a toujours su conserver à la fois de la distance et de la proximité avec l’ère de son temps.
Beaucoup de l’imaginaire de Moebius a permis l’inspiration de ma vision sur Les Insomniaques. Je crois que j’ai toujours imaginé les visuels et design du récit avec ses couleurs en tête. Son influence se diffuse dans tous les autres travaux que j’ai réalisé, mais il est davantage capital sur ce roman et – sans doute un autre dont je parlerai le moment venu parce que là tout de suite c’est trop tôt – !
Il restera parmi les noms que je citerai, et j’aurais toujours un garage hermétique en livre de chevet !