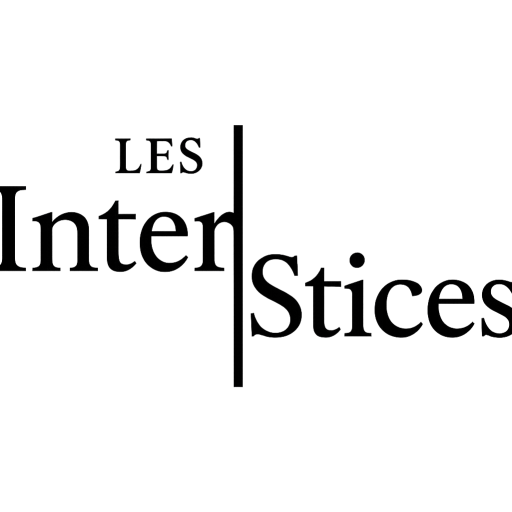Tous les jours, je me lève bien avant le réveil.
Le matin, il s’agit de s’extirper du cinquième de lit que ma compagne me laisse pour dormir, sans trop la remuer. Je descends les escaliers de notre appartement de quarante mètres carrés – dont je suis l’heureux propriétaire – et je file à la salle de bain.
Chaque matin, je scrute mon poids stagnant et le blanchissement progressif de mes cheveux. J’estime que d’ici six ans, à mes trente-cinq ans révolus, il ne restera qu’un tiers de mèches noires au milieu de cette foule de fibres.
D’ici là, j’espère que le prêt de l’appartement sera remboursé. Je ferai en sorte qu’il le soit. L’objectif, c’est de sécuriser. Conseil transmis par maman.
Pour moi, gérer le budget, c’est un objectif en soi. Un peu comme gérer son poids : le maintenir le plus stable possible, dans une fourchette de sécurité, entre 75 et 85. Là, je suis à 83 ; les chevaux sont un peu relâchés, approche le moment de la disette, contrainte et forcée.
Je compte autant les calories que les euros. Un sacré privilège : atteindre le luxe de pouvoir compter les calories est, à mes yeux, un marqueur de réussite civilisationnelle. On en est à gérer l’abondance, ce qui, pour des créatures dont l’essentiel de l’énergie vitale et de la motivation consiste à combler des vides, représente une victoire absolue sur le règne du vivant.
L’organisation occidentale nous a permis, d’ailleurs, de satisfaire – pour ceux qui ont été suffisamment domestiqués par leurs parents et/ou leurs pairs – l’essentiel de nos besoins, à condition de respecter quelques codes sociaux.
C’est pour ça que, lorsque je sors dans les rues de la ville, je suis toujours un peu circonspect devant tant de misère sociale. Là, un badaud vêtu de guenilles, avec la crasse qui agglomère les poils de ses bras, traîne constamment son sac Action, qui semble être le seul qu’il possède.
Son regard, toujours hagard, ne trouve jamais de point fixe. Il balaie son champ visuel à la recherche d’une menace susceptible de meurtrir son corps chétif. Cependant, il se peut que son strabisme explique le phénomène. J’ose espérer que cela trahisse, en réalité, un dysfonctionnement organique, et non les signes d’une insécurité chronique, d’une anxiété généralisée, ou pire, d’une forme de paranoïa.
Ah oui, je suis psychologue, au passage.
Ce badaud-là n’est pas le seul de la rue. Un autre, plus renfrogné, garde la tête rentrée à jamais dans ses épaules trapues, pour se protéger des regards. Son problème, c’est la gigantesque tache de vin qui couvre les trois quarts de son visage. Et il sait qu’on la regarde : il a l’œil mauvais, comme s’il se tenait prêt à défendre sa dignité.
Dans son attitude, sa manière de longer les murs, de jeter des œillades agressives, je sais qu’il a souffert toute sa vie. Désormais, chaque regard, chaque bonjour qu’on lui adresse, sont autant d’agressions.
Ces deux personnes ont un point commun.
Ils exsudent le malheur. Comme si les maltraitances de leurs vies suintaient par leurs pores.
Et cette misère affective, physique et psychique les marginalise encore davantage. Un autre facteur d’échec d’insertion sociale.
Mais ils ont l’air encore un peu intégrés. Pauvres, mais pas complètement en déchéance.
Je pense que ce sont eux qui auraient le plus besoin d’un psychologue, et qui mériteraient d’être aidés.
Personnellement, je bosse en institution, dans la fonction publique. Je suis là pour offrir du soutien psychologique à une population exposée à un stress chronique et potentiellement extrême. Non pas que ça ne serve à rien, mais j’aide des gens qui, par définition, sont intégrés et dont la situation sociale est relativement garantie.
Et chaque fois que je croise ces types dans la rue, je me dis que je devrais aller travailler dans des services plus sociaux.
M’exposer à des gens qui pourraient tirer le maximum d’un peu de psychoéducation, pour qu’ils puissent envisager que si la vie a été une garce jusqu’ici, ce n’est – peut-être – pas une fatalité.
Peut-être que ces gars pourraient un jour sourire en croisant des gens dans la rue.
Et ces réflexions s’enlisent dans ma tête.
Mais pour l’instant, je grimpe dans ma voiture de service – autre privilège – et je fonce vers mon premier entretien.
Sur la route, la sono crache l’une des vingt musiques que je fais tourner en boucle. Soit des thèmes de jeux vidéo, soit un rappeur qui raconte la vie d’un gangster conscient d’avoir fait tous les mauvais choix, et qui ne peut plus que s’enfoncer dans la violence, l’argent facile, et les relations où l’attachement est prohibé.
Parce que même si le mec est capable d’arracher des chicots à la pince, il ne veut pas briser le cœur des meufs.
J’adore ces paradoxes purement masculins. Éclater la gueule d’un autre gangster ? Cool. Mais s’attacher à une femme au risque de la faire souffrir ? Non.
Je peux respecter ça.
Lorsque j’arrive sur les lieux, j’entre dans le bureau, et il est déjà là.
Ses cernes sont un peu moins creusés cette fois. Je lui fais la remarque en lui lançant qu’il a une gueule « à peine moins pire que la dernière fois ».
Son visage se déride l’espace d’un clignement d’œil, avant que ça ne commence à dégobiller du malheur pendant une heure.
Le gars a porté son couple et sa famille à bout de bras pendant vingt ans. Il contrôlait tout : les besoins de chacun, mettait de côté, sécurisait, a fait en sorte d’offrir une grande maison à sa femme, leurs deux gosses, et à la belle-mère qui squattait sous prétexte de garder les petits-enfants, alors qu’elle ne supportait simplement pas sa solitude de femme célibataire dans le dernier quart de sa vie.
Sa femme a commencé à se séparer de lui il y a huit mois, et, par la sadique stratégie de la grenouille ébouillantée, a lentement décomposé leur vie commune, morceau par morceau.
Maintenant, le contrat de divorce est sur la table, accompagné de la menace d’une garde exclusive des enfants pour madame.
Et tout en l’aidant à moins penser à la corde, et plutôt à l’utilité qu’il aura encore en tant que père pour le reste de sa vie, je me rends compte que la pente qui l’a mené là, c’est aussi la mienne.
Il a voulu sécuriser pour les siens, mais à la fin, on lui a reproché de ne pas assez respirer la vie.
Et ça me pèse.
Mais il a besoin que je sois le réceptacle de ses tourments, un interlocuteur fiable, pas un pote.
Tous les jours, les mots des autres roulent sur mes pensées, et je sens les sédiments boucher lentement ma capacité à ressentir.
Quand je reviens à l’appartement, après trois ou quatre autres entretiens qui m’ont fait traverser tout le département, elle est là, toujours heureuse de me voir.
Et j’ai toujours un peu de mal à lui parler de ma journée, ou de moi. Je ne saurais plus dire ce qui vaut la peine d’être raconté.
Je lui parle de ce que j’écris, qui n’a que peu à voir avec mon travail.
D’autant que je sais qu’elle en bave aussi. Isolée géographiquement d’une famille jamais très sécurisante, endeuillée depuis trois mois de son grand-père – seule vraie figure présente et bienveillante de son entourage, malgré la vie difficile du bonhomme.
Elle aussi marche sur un fil. Elle sent que la bascule n’est pas loin. Elle a envie de lâcher pas mal de choses, dont ses rêves.
Alors, du haut des cinq ans qui nous séparent, j’essaie d’être le meilleur conseiller possible. D’être cadrant sans oublier qu’on est un couple, une équipe, et que je ne veux pas lui retirer son libre arbitre.
Elle est incapable d’une seule chose : voir tout le potentiel qu’elle a, et y croire.
Alors je veux être ses yeux. Parce que c’est la personne qui mérite mon énergie.
À cet instant, son souffle chasse les restes du jour.
Les patients ont mes journées de travail. Les badauds en auront peut-être un jour aussi.
Mais le reste, c’est pour nous.
Quant à ce qu’il reste de moi…
Retrouvez ce texte et bien d’autres dans le premier numéro de la revue de L’Athènes du Nord.